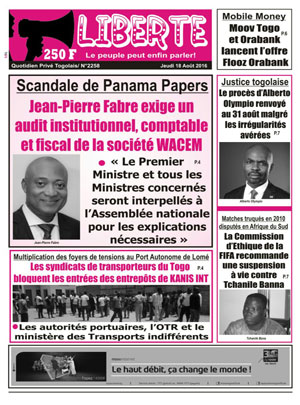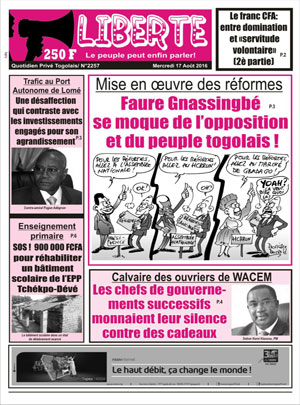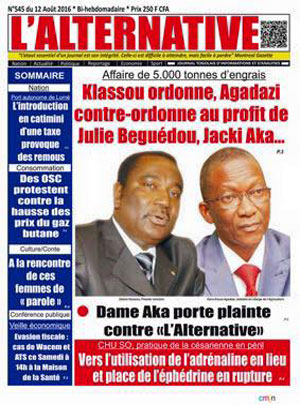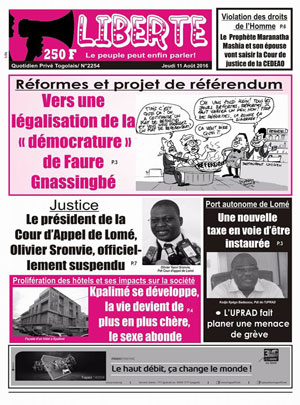Sans donner son avis sur telle ou telle autre option,
entre la voie parlementaire ou référendaire, le président de OBUTS,
Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, invité de l’émission hebdomadaire « Un
Œil sur l’Actualité » de nos confrères de LCF, hier dimanche, pense
qu’il faudra ouvrir le débat pour définir finalement laquelle choisir.
Il reconnait de toutes les façons que « de manière objective, c’est une
révision profonde », car constate-t-il que le travail qui a été fait
lors des travaux du HCRRUN sur les réformes politiques et
institutionnelles est colossal.
Sans donner son avis sur telle ou telle autre option,
entre la voie parlementaire ou référendaire, le président de OBUTS,
Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo, invité de l’émission hebdomadaire « Un
Œil sur l’Actualité » de nos confrères de LCF, hier dimanche, pense
qu’il faudra ouvrir le débat pour définir finalement laquelle choisir.
Il reconnait de toutes les façons que « de manière objective, c’est une
révision profonde », car constate-t-il que le travail qui a été fait
lors des travaux du HCRRUN sur les réformes politiques et
institutionnelles est colossal.
Revoici l’intégralité du document de synthèse transmis au Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé...
SYNTHESE
ATELIER NATIONAL DE REFLEXION ET D’ECHANGES SUR LES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES
(L’Hôtel Radisson Blu 2 février du 11 au 15 juillet 2016)
« Nous avons besoin désormais d’institutions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent ».
Cette affirmation pose la question de la réforme des institutions et
surtout de sa contextualisation. La réforme devant se faire par la
République, dans la République et pour la République de demain, une
clarification conceptuelle s’impose.
Au sens générique, le terme république ne peut faire l’objet que d’une
définition négative : il désigne le régime politique dans lequel la
fonction de chef d’Etat n’est ni héréditaire, ni viagère. Doit-on en
conclure que république est synonyme de démocratie ? En aucun cas, le
terme est parfois utilisé pour désigner l’Etat ; La Fayette présentera
Louis-Philippe d’Orléans, comme la « meilleure république. Aujourd’hui
on peut concevoir la République comme un système sans roi ni dictateur,
un Etat de droit, une démocratie libérale ».
Au-delà, la République porte sur des valeurs sans lesquelles elle ne
peut exister. Ces valeurs font curieusement défaut au Togo et ce depuis
les indépendances. En effet, depuis cette période tout semble opposer
les togolais. Les dissensions sont sociales, économiques, sociologiques,
anthropologiques et rarement idéologiques. Les dates importantes de
l’histoire commune divisent les togolais plus qu’elles ne les
rassemblent. Les symboles de l’Etat sont dévoyés. Les héros sont
méconnus. Au-delà de ces valeurs, la classe politique porte ou promeut
rarement des valeurs d’amour de la patrie, de citoyenneté, d’intérêt
général, de consensus, du respect de l’autre, de l’acceptation de
l’autre et des différences. On comprend dès lors que les essais préparés
depuis les indépendances, aient déjà et chaque fois échoués avant même
qu’ils ne prennent corps. Les textes portent en eux des crispations
politiques. La catégorisation opérée entre conservateurs, rénovateurs et
exclus semble ne pas prendre en compte le consensus, l’acceptation et
la valorisation des différences.
Il urge donc que des mesures soient prises afin de rénover la
République, de placer les valeurs au cœur de la République et d’œuvrer
la promotion de celles-ci. C’est ce qui justifie la création du HCRRUN,
puisqu’il a pour mission la mise en œuvre des recommandations de la
CVJR. Il est clair que c’est dans cette optique qu’il faut placer cet
atelier qui a regroupé les forces vives de la Nation togolaise, afin de
baliser les voies du processus de réformes à travers des propositions
qui serviront de document de travail à la Commission de Réflexion sur
les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles.
Il faut alors que les Républiques discutées cèdent le pas à la
République rénovée. Les échanges et les débats de la Salle Fazao du 11
au 15 juillet 2016 ont révélé un souhait unanimement partagé, c’est
celui d’une République métamorphosée. La pédagogie nous impose de faire
observer que cette amélioration de la République ne se fera qu’après des
préalables politiques (I). Toutefois, les échanges fructueux de ces
derniers jours autorisent l’esquisse d’un modèle à travers les mutations
suggérées (II).
I. Les préalables politiques
Ce qui est juste moralement, socialement et juridiquement peut devenir
politiquement suicidaire a-t-on dit pour décrire la complexité de
l’action politique. Qu’il nous soit permis de poser un postulat.
Pour voguer vers les changements souhaités, il faudrait dresser le portrait robot du politique.
Pourquoi ne pas retenir celui proposé jadis par Platon, c’est-à-dire un
hybride entre homme de savoir et pasteur conduisant un troupeau ?
C’est ce modèle de leader qui devrait nous mener vers les préalables
politiques. Au cœur de ces préalables trône la notion de consensus. Il
s’agit d’un maître-mot que l’on a considéré comme le mode le plus adapté
de recherche de la conciliation entre les peuples. Toutefois, un écueil
s’élève immédiatement devant nous : quel contenu faut-il donner à une
telle notion ? Certes, le terme consensus nous rapproche du compromis.
On peut l’entendre, non comme une opinion adoptée par une majorité, mais
plutôt comme un processus, une construction. L’idée de construction est
séduisante parce que le consensus suggère l’apport de multiples
opinions différentes, et leur adaptation progressive jusqu’à ce qu’une
solution satisfaisant le plus grand nombre de personnes puisse être
dégagée. Le consensus ne signifie pas forcément que tout le monde est
satisfait du résultat, mais induit plutôt que tout le monde peut juger
le résultat acceptable et que la majorité est satisfaite.
Le consensus est heureusement un facteur d’inclusion. Par expérience les
togolais, sont à même de dire que l’exclusion génère la frustration et
est un ferment de blocage des évolutions entreprises. Il faut donc
s’accorder sur le fait qu’une réforme est nécessairement un phénomène
collectif impliquant une multitude d’acteurs. Ces acteurs opérant dans
un champ institutionnel dominé par des rapports de force où les uns sont
considérés comme des réformateurs et les autres, comme des résistants
aux changements, la recherche de solutions construites en commun est
conséquemment un gage de faisabilité et de fiabilité dans la durée.
Il est revenu au cours des échanges que la confiance constitue un
élément décisif de la relation à établir entre les uns et les autres.
Emmanuel-Joseph Sieyès, affirmait « la confiance doit venir d’en bas et
le pouvoir d’en haut ». Mais, il est préférable de convoquer ici, Paul
de Gondi, Cardinal de Retz qui dans ses Mémoires, disait : « Savoir se
fier est une qualité très rare, et qui marque autant, un esprit élevé
au-dessus du commun ». Pour faire confiance, il faut pouvoir croire en
les autres et accepter le risque de la dépendance. C’est pour cela que
la confiance n’est jamais neutre ». Elle est fondamentale car, sans
confiance, il serait difficile d’envisager l’existence même des
relations humaines -des rapports de travail jusqu’à l’amitié ou bien
l’amour.
Sans la confiance, l’entreprise menée est fatalement vouée à l’échec.
Pourquoi ? Tout simplement parce que l’on ne pourrait même pas envisager
l’avenir et chercher à bâtir un projet qui se développe dans le temps.
Comme l’explique Niklas Luhmann, c’est la confiance qui rend possible le
développement de la socialité, et le fonctionnement de la démocratie.
L’on notera tout simplement que la confiance est « un certain niveau de
probabilité subjective », ce qui devrait permettre à un politique
togolais de croire que l’autre accomplira ce qu’il attend de lui. Faire
confiance à un compatriote signifierait dès lors d’envisager une
possible coopération.
L’exigence de bonne foi liée aux discussions politiques ne doit pas être passée par pertes et profits.
Les partis politiques sans aucune distinction, cela a été relevé,
gagneraient en crédibilité s’ils faisaient preuve de bonne foi, de
résilience. Ne faudrait-il pas s’inspirer de Nelson Mandela qui disait :
« Si vous n’êtes pas prêt à faire des concessions n’allez pas aux
négociations ! ». Le rôle des formations politiques et des parties
prenantes consistera à rassembler, à représenter les intérêts sociaux,
servant ainsi de structures républicaines établies, pour la
participation politique. La modération et la pondération des leaders
seront utiles pour atteindre les objectifs visés.
Qu’en est-il du sens de l’intérêt général ? Un participant martelait que
tant que les uns et les autres ne regarderont la République qu’à
travers le prisme de leurs intérêts personnels, les maux de notre
société ne trouveront nullement de solutions. Il faut en tirer que seul
l’intérêt général, qui n’est pas la résultante de la somme des intérêts
individuels, mais plutôt une finalité d’ordre supérieur aux intérêts
individuels doit guider l’action politique. La référence l’intérêt
général devient, dans un tel contexte, la pierre angulaire du système
politique : la condition de l’obéissance politique repose sur la
certitude que l’action publique poursuit un intérêt général. C’est une
finalité à laquelle le politique togolais est censé se soumettre.
Au total, et cela a été parfaitement relevé, c’est l’état d’esprit
idéologique des acteurs dans le processus des réformes politiques et
institutionnelles qui appelle un reformatage. Il faut changer de
paradigme. Seule une telle opération permettra d’envisager la
participation des acteurs au travers du prisme des conditions
d’efficacité des réformes. Pour baliser la voie des réformes des
changements ont été proposés.
II. Les mutations suggérées
La richesse des discussions de la salle Fazao, de l’hôtel Radisson Blu 2
février n’est plus à rappeler. Ce sur quoi il faut attirer l’attention,
ce sont les mutations souhaitées et proposées. Pour la commodité du
propos, ces mutations doivent, d’une part, être envisagées dans leur
conception (A) et d’autre part dans leur aménagement (B).
A. Les mutations dans leur conception contexte togolais
Concevoir la mutation dans le contexte togolais impose un travail
d’orfèvrerie constitutionnelle qui consiste à intervenir sur certains
éléments de la constitution détectés par consensus et dont le changement
donnera un nouveau lustre au système politique tout entier. Il a, par
exemple, été proposé une décongestion de la fonction présidentielle et
la moralisation du pouvoir politique. Ce qu’il faut retenir, c’est la
volonté de mieux définir l’exécutif et de le contrôler. Dans les
évolutions à entrevoir, la clé de voûte du système demeure le Chef de
l’Etat. Cependant, il faudrait redéfinir son rôle en accentuant et en
encadrant son rôle d’arbitre, et en faisant de ce dernier le garant des
valeurs de la Nation et des enjeux du long-terme.
La question du mandat n’a pas été passée sous silence. Elle devra être
réglée. Au plan conceptuel, le mandat limité dans le temps a semblé
emporter l’assentiment d’une large frange des participants de l’atelier.
Dès lors, les mutations à intervenir devraient prendre en considération
un mandat à terme fixe renouvelable une fois et un scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
La volonté, d’avoir un parlement dynamique et revalorisé, a été
exprimée. Le parlement dans l’esquisse est plus actif, renforcé, plus
représentatif. Il doit certainement épouser son temps. Il doit également
résister à son temps en limitant par exemple les pouvoirs du
Gouvernement au sein de la procédure législative pour les aligner sur
ceux des parlementaires et des Commissions, en modernisant la procédure
législative, et en renforçant les instruments de contrôle. Il doit
finalement anticiper sur son temps en plaçant le citoyen au cœur de
cette architecture parlementaire renforcée. Il est ressorti que les
instruments de contrôle de l’action gouvernementale, le statut de
l’opposition et les droits y afférents doivent être renforcés. La
démarche ne consistera donc pas à créer un régime politique-monstre
constitutionnel. Il sera plutôt question de déterminer son contenu afin
que la dénomination s’impose d’elle-même.
La mise en place du Sénat au regard du bilan coûts /avantages ne paraît
pas prioritaire, elle devrait être discutée à nouveau. La question
ethnique est apparue sous les atours d’un obstacle à la cohésion
nationale. Il faudra alors la creuser à nouveau afin de déterminer un
nouveau modèle.
Notre République est un Etat de droit. Or, la justice est un droit et un
devoir pour l’Etat de droit. Notre justice doit nous ressembler, d’où
la contextualisation de nos textes. L’indépendance de la justice devra
être réaffirmée et consolidée. Bien entendu, la réforme de la Justice
est enclenchée, elle doit se poursuivre et s’accentuer. Une telle
réforme devrait toucher la justice judiciaire, celle administrative et
celle constitutionnelle avec un accent particulier sur la spécialisation
des magistrats.
Concernant la justice constitutionnelle, il a été proposé une réforme
des modalités de sa saisine. La suppression du juge unique en première
instance est envisagée, de même que l’institution d’un collège en ses
lieu et place. Il faut garder à l’esprit avec Mamoussé DIAGNE que
« l’Etat de droit n’est pas tant le lieu d’annulation du conflit que
celui de sa gestion et de son arbitrage dans les limites de la raison ».
B. Les mutations dans leur aménagement
Pour réhabiliter la République, il faut bien évidemment partir de
l’existant. Qu’entend-on par l’existant ? Ce sont tous les acteurs, au
premier chef, le chef de l’Etat. Au Chef de l’Etat, les participants ont
souhaité la volonté politique, pour voler au-dessus de la mêlée. La
réhabilitation de la République devrait se faire sous son impulsion. Une
précaution tout de même, réhabiliter la République ne se décrète pas,
elle se construit pas à pas.
La part des citoyens dans la réhabilitation ne doit pas être négligée.
Leur sens de la chose publique est convoqué. Leur civisme, leur
éducation. Ils sont les acteurs du changement. Ils devront être formés
dans ce sens et se tenir prêts et faire preuve de responsabilité
lorsqu’ils seront consultés sur les grandes orientations que nous
souhaitons donner à notre pays.
La réhabilitation de la République ne se fera pas sans l’armée. L’ordre
politique doit prendre le pas sur l’ordre militaire, que « les armes le
cèdent à la toge » selon les mots de Cicéron. La déconnexion du
militaire du politique illustrerait l’idée selon laquelle l’armée est au
service du peuple.
L’armée préserve les intérêts de la Nation, défend les institutions et
non les hommes. Il ne faut pas perdre de vue que la sécurité et le
développement ont partie liée. La politique étant appelée à rechercher
un équilibre harmonieux des stratégies et mesures de sécurité et de
développement. Il n’y a donc pas de sécurité sans développement, ni de
développement durable sans sécurité. Une évolution des mentalités
s’impose.
Relativement au problème foncier qui se pose avec une rare acuité dans
notre pays, des initiatives sont prises dans le sens de la réforme.
Elles devront aboutir. Il en va ainsi car, il ne saurait y avoir de
décentralisation sans délimitation parfaite du territoire national. De
même, il ne pourrait y avoir de prospérité sans propriété. Le droit de
propriété est garanti par la Constitution togolaise (Art. 27). Il faut
rendre cette garantie effective, nous aurons rendu service à notre pays.
Pour ce qui concerne la religion, il importe de rappeler que notre pays
est laïc. Dès lors, la diversité religieuse a vocation s’exprimer
pleinement sur le territoire. Mais cette expression ne saurait faire
l’économie du respect de l’ordre public et les bonnes mœurs. Les
responsables religieux ont une part importante à jouer dans
l’édification du Togo de demain. Oui ! L’on doit éduquer la citoyenneté
au Couvent, l’Eglise, la Mosquée, dans les Temples.
La réhabilitation de la République empruntera également les chemins
escarpés de sa consolidation. Et sur ces chemins se dressera l’urgence
de la décentralisation. Il n’a pas été nié à la salle Fazao
qu’aujourd’hui le pilotage du navire-Togo exclusivement à partir du
poste de Lomé est ineffectif, inefficace, inefficient. Il est d’ores et
déjà acquis que la solution réside dans la décentralisation. Des jalons
sont jetés. Mais l’effectivité d’une démocratie locale reste une
espérance, une bonne espérance vers laquelle nous devons derechef mettre
le cap. Réussir la démocratie locale c’est également réussir la
démocratie. L’exemple ghanéen devrait irriguer notre réflexion. L’on
peut convoquer le général Wesley Clark qui fait reposer la démocratie,
non sur trois pieds mais plutôt sur quatre piliers : la bonne
gouvernance, la participation massive du peuple, la tolérance et l’Etat
de droit. Il ne s’agit pas d’une fin en soi, mais d’une construction
permanente.
HCRRUN